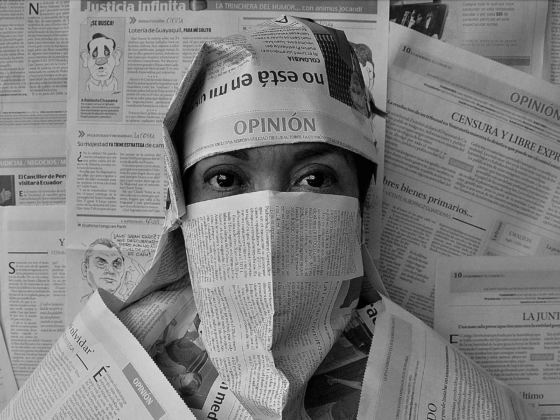Toute personne ayant grandi dans un foyer musulman connaît très certainement les histoires de Djoha qui ont fait rire des générations en se transmettant à l’oral. Au-delà de leur aspect humoristique, ces célèbres anecdotes contiennent souvent une morale et peuvent être interprétées de différentes manières. Celles-ci ont circulé largement dans l’espace et ont pénétré diverses cultures à travers les continents ayant adopté Djoha. Du monde arabe aux Balkans, jusqu’en Chine, une riche tradition s’est perpétuée, rassemblant plusieurs milliers de récits satiriques dans lesquels Djoha est dépeint tantôt comme drôle, tantôt comme sage, ou encore comme l’idiot du village devenant l’objet d’une risée générale.
Cette grande notoriété a donné lieu à maintes spéculations quant à l’origine du personnage. De nombreux pays se sont approprié cette figure emblématique en l’adaptant à leurs conditions sociales et culturelles. Djoha est ainsi devenu un héros folklorique qui, selon les régions, serait originaire du Moyen-Orient, de Turquie, d’Iran, d’Ouzbékistan ou encore du Xinjiang. Un certain mystère entoure ainsi ce personnage quasi mystique selon ces traditions orales.
Or, Djoha est un personnage historique peu connu pour le rôle qu’il a effectivement joué dans la transmission de hadiths prophétiques.
DJOHA ET LA SCIENCE DU HADITH
La science du Hadith (‘Ilm al-Hadith) constitue une discipline unique et propre à la civilisation musulmane. Elle comprend plusieurs branches permettant d’évaluer et de catégoriser les Hadiths prophétiques. La plus connue est celle du Moustalah al-Hadith, par laquelle les érudits déterminent l’authenticité de la chaîne de transmission (al-Sanad) et du texte (al-Matan) du Hadith. Une autre branche, ‘Ilm al-Rijâl, se consacre à l’étude des narrateurs de Hadith et présente une évaluation minutieuse ainsi qu’une biographie de chacun d’entre eux. Ces sciences extrêmement pointilleuses ont permis de distinguer les Hadiths authentiques de ceux qui sont faibles ou inventés.

Pour qu’une chaine de transmission soit acceptée, tous les narrateurs dans le « Sanad » doivent répondre à des critères stricts. Si un narrateur est connu pour mentir, pour commettre des erreurs lors de sa narration, pour un manque d’exactitude, pour une mémoire défaillante, etc., alors sa narration sera rejetée. Les gens de sciences sont unanimes sur le fait qu’un Hadith ne peut être accepté que s’il provient d’un narrateur jugé juste et équitable (’Adl).
L’ensemble des narrateurs de Hadiths étaient donc étudiés et évalués de manière détaillée afin de garantir l’authenticité des Hadiths rapportés du Prophète ﷺ en ainsi préserver sa Sounnah, qui constitue la deuxième source de la tradition après le Coran. Leurs biographies ont été rédigées par de grands érudits et précieusement conservées à travers les siècles.
C’est dans ces livres de biographies des Muhaddithin que nous trouvons les premières traces de Djoha qui n’était pas un personnage mythique, mais un narrateur de Hadith du VIIe.
LE VÉRITABLE DJOHA
De son vrai nom Abou al-Ghousn Doujayn Ibn Thâbit al-Fizari, Djoha est né durant le Califat omeyyade en l’an 60 de l’hégire (correspondant à l’an 679) en Iraq [1]‘Abd al-Sittîr Ahmed Farâj, « Kitâb Aghbâr Djoha, Dirâsa wa Tahqîq ». Il passa la plus grande partie de sa vie à Koufa où il décide en l’an 160 de l’hégire (777)[2] Le Mouhaddith ‘Ali Ibn al-Asâkir (1105-1176) rapporte que Djoha a vécu plus de cent ans (hégiriennes)..
L’érudit Châfi’ite Abou Ishâq al-Chayrâzi (1003-1083) rapporte que Djoha était le surnom de Doujayn al-Fizari qu’il décrit comme un homme avenant et intelligent tout en rajoutant que « ce qui a été propagé sur lui relève de la calomnie »[3]Ibn Châkir al-Kutubi, « ‘Uyûn al-Tawârîgh »..

Djoha faisait partie des Tâbi’în, la génération de musulmans qui ont succédé les Compagnons du Prophète ﷺ et les ont rencontrés. L’imam al-Boukhari (810 – 870) rapporte que Djoha a rencontré le célèbre compagnon Anas Ibn Malik et qu’il a rapporté de plusieurs sources telles qu’Aslam (l’affranchi d’Omar ibn al -Khattâb), Hichâm Ibn ‘Urwa, Abdullah Bin Moubârak et d’autres savants du Hadith[4]Al-Boukhari, « Târigh al-Kabîr »..
Ce n’est qu’au IXe que Djoha apparait en tant que figure folklorique dans la littérature arabe, devenant largement populaire au XIe. Plusieurs érudits vont alors prendre sa défense comme Ibn al-Jawzi (1116 – 1201) qui le décrit ainsi :
« Et parmi eux il y a Djoha qui portait le surnom d’Abu al-Ghousn. Ce qui a été rapporté de lui démontre sa perspicacité et son intelligence, bien qu’il ait largement été qualifié de “distrait”[5]Le terme de « distraction » (al-Ghafla) est utilisé chez les érudits du Hadith pour désigner des narrateurs qui sont devenus distraits par leurs adorations et ont ainsi été détournés par … Continue reading. Il est aussi dit que certaines personnes nourrissant une hostilité à son égard ont inventé des contes autour de sa personne. »[6]Ibn Châkir al-Kutubi, « ‘Uyûn al-Tawârîgh ».
LES PLAISANTERIES DE DJOHA
Dans son fameux Mîzân al-‘Itidâl, l’Imam al-Dhahabi (1274-1348) revient sur le caractère de Doujayn al-Fizari : « Djoha faisait partie des Tabi’în et sa mère était une servante d’Anas bin Malik. Il était connu pour sa tolérance et sa nature accommodante. Il ne convient donc pas à quiconque de se moquer de lui lorsqu’on entend les histoires drôles à son sujet. »[7]Imam al-Dhahabi, « Mîzân al-‘Itidâl fi Naqd al-Ridjâl ».

Al-Dhahabi rapporte également que Djoha appréciait les plaisanteries durant sa jeunesse, mais « une fois qu’il prit de l’âge, il devint plus sérieux » et « les érudits acceptaient les Hadiths qu’il transmettait »[8]Certains Muhaddithin (comme Ibn Ma’în, Abu Hâtim, Abu Zour’a, al-Nasâ’i) considéraient Doujayn al-Fizari comme un rapporteur faible et rejetaient ses Hadiths. D’autres comme Ibn … Continue reading. Certains de ses rapporteurs l’ont décrit comme étant particulièrement sage.
Il est donc probable que durant sa jeunesse, Djoha se fit connaître par ses plaisanteries qui furent ensuite relayées et transformées en anecdotes populaires et lui confèrent une réputation qui désormais le précèdent.
De nombreux savants dont l’érudit égyptien ‘Abd al-Rahmân Jalâl al-Dîn al-Suyûti (1445 – 1505) affirment que la grande majorité des anecdotes attribuées à Djoha n’ont aucun fondement véridique[9]Ibn Châkir al-Kutubi, « ‘Uyûn al-Tawârîgh ».. Selon l’historien et Muhaddith égyptien ‘Abdal-Wahhâb al-Cha’râni (1492-1565), l’Imâm al-Suyûti aurait même rédigé un ouvrage consacré à Djoha[10]Nommé « Irchâd Man Nahâ Ila Nawâdir Djoha ». en réponse à une question sur sa personne[11]« Al-Manhaj al-Moutahhar Lil Qalb wa al-Fawâ’id »..
LA PROPAGATION MONDIALE DES ANECDOTES DE DJOHA
En 987, le biographe musulman Ibn al-Nadim publie Kitâb al-Fihrist, un ouvrage qui fait référence à plus de 9 000 livres et 2 000 auteurs. C’est aussi le premier ouvrage à rassembler les anecdotes de Djoha dans un seul chapitre (intitulé Nawâdir Djoha). Ces histoires seront ultérieurement adoptées par d’autres cultures qui en conserveront le substance tout en adoptant les noms des lieux, des personnages et le contexte historique.

En Turquie, Djoha deviendra ainsi connu sous le nom de Nasr Eddin Hodja (ou Nasrettin Hoca), un personnage légendaire supposément originaire de l’Anatolie du XIIIe siècle, dont l’existence historique demeure incertaine. Le Djoha turc est aussi dépeint comme un juge hanafite qui aurait affronté le conquérant turco-mongol Tamerlan. Le plus ancien manuscrit relatant les histoires de Nasr Eddin date de 1571.
Le nom de Djoha sera légèrement adapté selon la langue ou du dialecte de chaque région qui s’approprie ses anecdotes. Au Maroc et en Algérie, il est appelé Jha ou Djeha. En Égypte, on le nomme Goha. En Afghanistan, en Iran et en Azerbaïdjan, il est connu comme Mollah Nasreddin tandis qu’au Xinjiang, il porte le nom ouïgour d’Afanti. Pourtant, toutes ces figures remontent à une seule personne historique : le narrateur de Hadith Doujayn Ibn Thâbit al-Fizari.
__________________________________________________________________
Nos frères et sœurs à Gaza subissent actuellement un génocide rendu possible, soutenu et financé par un grand nombre de pays occidentaux. Ne les oublions pas dans nos invocations.
__________________________________________________________________
Références
| ↑1 | ‘Abd al-Sittîr Ahmed Farâj, « Kitâb Aghbâr Djoha, Dirâsa wa Tahqîq » |
|---|---|
| ↑2 | Le Mouhaddith ‘Ali Ibn al-Asâkir (1105-1176) rapporte que Djoha a vécu plus de cent ans (hégiriennes). |
| ↑3 | Ibn Châkir al-Kutubi, « ‘Uyûn al-Tawârîgh ». |
| ↑4 | Al-Boukhari, « Târigh al-Kabîr ». |
| ↑5 | Le terme de « distraction » (al-Ghafla) est utilisé chez les érudits du Hadith pour désigner des narrateurs qui sont devenus distraits par leurs adorations et ont ainsi été détournés par la mémorisation (très précise) du Hadith. Il ont ainsi commis des erreurs. |
| ↑6 | Ibn Châkir al-Kutubi, « ‘Uyûn al-Tawârîgh ». |
| ↑7 | Imam al-Dhahabi, « Mîzân al-‘Itidâl fi Naqd al-Ridjâl ». |
| ↑8 | Certains Muhaddithin (comme Ibn Ma’în, Abu Hâtim, Abu Zour’a, al-Nasâ’i) considéraient Doujayn al-Fizari comme un rapporteur faible et rejetaient ses Hadiths. D’autres comme Ibn al-Moubârak et Wakee’i acceptaient ses Hadiths (voir ‘Abd al-Sittîr Ahmed Farâj, « Kitâb Aghbâr Djoha, Dirâsa wa Tahqîq »). |
| ↑9 | Ibn Châkir al-Kutubi, « ‘Uyûn al-Tawârîgh ». |
| ↑10 | Nommé « Irchâd Man Nahâ Ila Nawâdir Djoha ». |
| ↑11 | « Al-Manhaj al-Moutahhar Lil Qalb wa al-Fawâ’id ». |