Lorsque des intellectuels ou militants antiracistes parlent d’islamophobie pour dénoncer certaines réalités, ils subissent souvent de violentes critiques, rendant impossible tout débat serein. On leur rétorque que « l’islamophobie n’est pas du racisme, car les musulmans ne sont pas une race », que « la crainte de l’islam est parfaitement justifiée vu les attentats terroristes », que « le mot islamophobie sert à rendre impossible toute critique de l’islam », que « c’est une invention de Khomeini », que « chez nous, personne n’est discriminé à cause de sa religion » ou encore que « l’islamophobie n’existe pas ».
Ces réactions virulentes ne se limitent pas aux discussions de comptoir : on les retrouve également, sous différentes formes, dans des tribunes d’opinion et des débats télévisés. En France, on les retrouve dans les discours de la fachosphère et dans les argumentations xénophobes d’une militante hystérique qui se prétend anthropologue.
Aux Pays-Bas, le chercheur et expert en islamophobie, Martijn de Koning, a déconstruit les cinq mythes les plus répandus sur l’islamophobie dans une recherche approfondie[1]https://www.kifkif.be/files/E-books/Vijf-mythen-over-islamofobie/islamofobie-martijn_20190523.pdf . Il met en lumière les erreurs de raisonnement les plus fréquentes et montre que ce concept a toute sa place dans les débats contemporains sur le racisme et la discrimination [2]Ce qui suit est un résumé de la recherche en question..
PREMIER MYTHE : « L’ISLAMOPHOBIE EST UNE INVENTION DE KHOMEINI »
Selon certains, le terme d’islamophobie aurait été inventé dans les années 1970 par l’ayatollah Khomeini afin d’empêcher tout débat sur l’islam. L’objectif aurait été d’assimiler l’islamophobie au racisme, pour la criminaliser.
Une variante de ce récit affirme que le mot a été forgé par l’Organisation de la coopération islamique (OCI). Or, même s’il est vrai que l’OCI et les autorités religieuses iraniennes ont effectivement tenté de contrer certaines critiques de l’islam, ces récits relèvent de la fabulation.
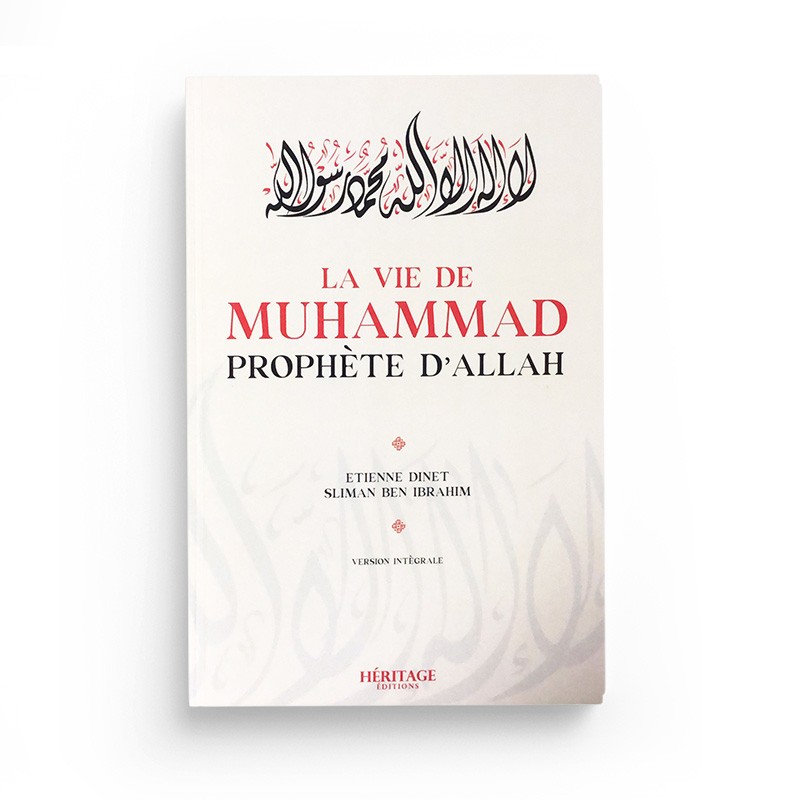
Comme pour de nombreux termes, il est difficile de déterminer exactement où le terme d’islamophobie a été utilisé pour la première fois. On le retrouve déjà dans des publications apparues en 1910. Par exemple, dans l’ouvrage d’Alain Quellien « La politique musulmane dans l’Afrique occidentale », ou encore dans un article de Maurice Delafosse publié dans la « Revue du monde musulman » [3]Maurice Delafosse, L’état actuel de l’Islam dans l’Afrique occidentale française, Revue du monde musulman, vol. XI, n°V, 1910, p. 53.. Delafosse y définit l’islamophobie comme une forme de gouvernance coloniale basée sur une distinction entre religions, qu’il oppose à l’islamophilie. Quant à Quellien, il analyse les préjugés historiques qui présentent l’islam comme l’ennemi du progrès, du christianisme et de l’Occident.
On cite aussi souvent l’ouvrage d’Etienne Dinet et Sliman Ben Ibrahim (« La vie de Mohammed, prophète d’Allah », 1918), qui employaient le terme pour discuter de l’hostilité de l’Europe envers l’islam et dénoncer le rôle des « islamophobes ». Cet ouvrage, publié à l’origine en français, fut traduit en anglais, mais le terme islamophobie n’y fut pas repris tel quel. En anglais, le terme apparaît pour la première fois dans des études scientifiques en 1925 dans le Journal of Theological Studies [4]FN Stanley A.Cook, Chronicle: The history of religions, Journal of Theological Studies, n°25, 1924, p. 101-109. (sans référence à l’usage du terme dans l’espace francophone) et plus tard en 1976 dans l’International Journal of Middle East Studies.
Il va de soi que le terme ne signifie pas la même chose partout. De plus, il est important de souligner que déjà dans des textes plus anciens, on indique que l’argument de l’islamophobie est parfois utilisé pour empêcher toute critique de l’islam.
Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si les auteurs qui affirment que l’islamophobie aurait été inventée par Khomeiny ou l’OCI ne fournissent jamais d’équivalent de ce mot en arabe ou en persan. Le terme n’existe tout simplement pas. Il existe certes des termes similaires (qui renvoient en général à l’hostilité envers l’islam), mais si Khomeiny et l’OCI ont employé le terme islamophobie, c’est qu’ils se sont appuyés sur un mot européen déjà en usage. En tout cas, Khomeiny, âgé de huit ans en 1910, avait sûrement d’autres préoccupations quand des universitaires européens utilisaient ce terme pour la première fois.
Lorsqu’on affirme que le terme « islamophobie » a été inventé par Khomeiny ou par l’OCI, c’est le plus souvent pour préparer l’argument selon lequel l’islamophobie n’existe pas, que ce n’est pas si grave et/ou qu’il ne s’agit que d’un nouvel exemple de musulmans susceptibles qui ne tolèrent aucune critique de l’islam. Ainsi, l’invocation de mythes de création erronés constitue souvent le point de départ d’un raisonnement plus long visant à rejeter l’ensemble du concept.
DEUXIÈME MYTHE : « L’ISLAMOPHOBIE EST UNE PEUR DE L’ISLAM »
De nombreux opposants au terme islamophobie le présentent comme un mot qui désignerait une forme de peur. Soit ils affirment qu’à l’égard d’une religion, il ne peut être question d’une « phobie » (au sens médical), soit ils soutiennent que la prétendue « peur » est en réalité une inquiétude légitime. Or, le concept d’islamophobie ne renvoie pas à une forme de peur pathologique. Le mot fait référence à un phénomène beaucoup plus large, dont les sentiments de peur ne constituent qu’un élément.
Malheureusement, le terme islamophobie est aussi souvent employé de manière similaire par ses partisans. Eux aussi le considèrent parfois comme une forme de peur irrationnelle de l’islam, à l’image de la peur irrationnelle que certaines personnes peuvent éprouver face à la hauteur, aux araignées, etc.
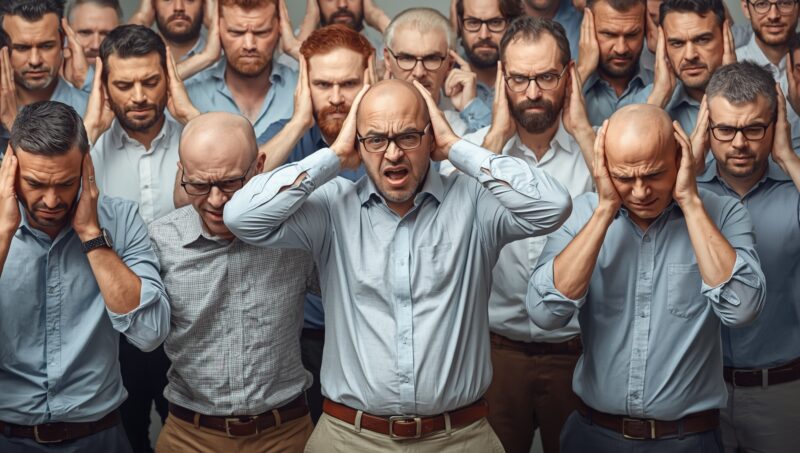
Mais s’agit-il d’une peur irrationnelle ? Oui, tout à fait, car il n’y a rien de menaçant en réalité. Il n’y avait, à titre d’exemple, aucun danger lorsqu’en mai 2016, aux États-Unis, un homme « d’apparence orientale » a été expulsé de son avion et interrogé comme suspect de terrorisme. En effet, le passager assis à côté de lui avait averti l’équipage au sujet des « signes très étranges » que l’homme notait sur sa tablette. Il s’agissait finalement d’un professeur italien de haut niveau qui travaillait sur des formules mathématiques d’une équation différentielle qu’il devait présenter un peu plus tard lors d’une conférence[5]Catherine Rampell, Ivy League economist ethnically profiled, interrogated for doing math on American Airlines, Washington Post, 07-05-2016.
Quand bien même on peut parler de peur irrationnelle dans ce cas, cela signifie-t-il pour autant que les passagers du train et de l’avion étaient islamophobes ? Cela pourrait sembler logique, puisque le mot « phobie » renvoie en lui-même à une peur excessive (irrationnelle), et puisque le Runnymede Trust, qui a popularisé le terme islamophobie, l’a lui aussi défini comme une forme de rejet de l’islam. Pourtant, l’islamophobie ne porte pas – ou en tout cas pas seulement – sur une peur psychologique.
Il est intéressant de constater que ces mêmes débats sémantiques n’ont généralement pas lieu pour des termes comme « homophobie » ou « xénophobie ». En règle générale, il est immédiatement compris et admis qu’il s’agit de phénomènes sociaux. Pour l’islamophobie, cela semble poser beaucoup plus de difficultés, bien qu’il s’agisse de dynamiques comparables.
Ainsi, l’islamophobie n’est pas tant une question de peur psychologique individuelle qu’une « peur sociale ». Il s’agit d’une sorte de panique sociale où, et par laquelle, certains actes intolérants et violents commis par des musulmans sont perçus comme typiques et essentiels de l’islam. Cette définition stéréotypée et stigmatisante de l’islam est ensuite appliquée à l’ensemble des musulmans – ou à toute personne perçue comme telle. Cela conduit finalement certains citoyens et décideurs politiques à se montrer extrêmement méfiants, hostiles, voire discriminatoires à l’égard des musulmans dans la société.
La peur personnelle n’est donc qu’une partie du phénomène. Il s’agit avant tout d’un rejet et d’une hostilité sociale vis-à-vis d’une représentation unilatérale et stigmatisante de l’islam, et de l’idée que cette version de l’islam expliquerait tous les comportements « problématiques » des musulmans, ceux-ci ne faisant, en somme, que suivre ce que cette image stigmatisante de l’islam leur prescrirait.
L’islamophobie n’est donc pas un terme psychologique qui décrirait l’état d’esprit d’un individu, mais bien un terme scientifique et militant qui désigne des processus sociaux spécifiques d’inclusion et d’exclusion visant les musulmans.
L’islamophobie n’est pas non plus un mot destiné à criminaliser la critique de l’islam ni un mot qui chercherait à problématiser le rejet individuel de musulmans ayant commis des actes terroristes. C’est au contraire un terme qui désigne l’ensemble des préjugés, stéréotypes et discriminations dont les musulmans font l’objet, en raison d’une interprétation unilatérale, négative et stigmatisante de leur tradition religieuse.
Selon certains, les stéréotypes et peurs sociales décrits ci-dessus seraient toutefois justifiés. Ils affirment alors que l’islamophobie n’existe pas, puisque le rejet et l’inquiétude à propos de l’islam seraient tout à fait logiques et nullement irrationnels. Ou bien – par un raisonnement similaire – ils admettent que l’islamophobie existe, mais « à juste titre », parce qu’il faudrait nécessairement avoir peur de l’islam. Ils renvoient alors (une fois de plus) à toutes sortes de violences et autres formes d’intolérance commises par des musulmans. Cette agressivité est ensuite attribuée à l’essence même de l’islam, ce qui rejaillit immédiatement sur tous les autres musulmans.
Certains introduisent toutefois une distinction entre pensées et actes : selon eux, le rejet de l’islam est acceptable, mais le vandalisme contre des mosquées ou les agressions physiques de musulmans sont à condamner. Ceux qui commettent de tels actes sont alors perçus comme des fous ou des extrémistes qui n’ont aucun lien avec l’image négative ni avec la peur sociale de l’islam.

Ce qui est intéressant, c’est que ce dernier groupe adopte une position apparemment contradictoire dans sa vision de l’islam. D’un côté, lorsque certains musulmans commettent des actes particuliers (par exemple rejoindre un groupe extrémiste), cela prouverait (selon eux) aussitôt à quel point l’islam, en soi, est mauvais, et donc à quel point cette religion influence le comportement de tous les autres musulmans. L’islam et les musulmans sont ainsi clairement associés. Mais d’un autre côté, ces mêmes personnes refusent d’établir une relation entre la stigmatisation des musulmans et les violences commises à leur égard. Selon elles, la haine attisée contre l’islam n’aurait aucune conséquence sur des comportements concrets et problématiques par lesquels certains des « notres » s’éprennent à l’un des « leurs ».
Or, si attiser la peur de l’islam n’avait vraiment aucun effet concret, on peut se demander pourquoi tant d’efforts sont déployés pour critiquer l’islam et propager la haine envers une communauté spécifique. Ou considère-t-on que susciter l’aversion contre l’islam n’a que des conséquences positives, et qu’il n’y aurait d’une manière ou d’une autre aucun effet négatif ?
Une fois de plus : l’islamophobie n’est pas une « pathologie individuelle », mais un phénomène social qui a également des conséquences concrètes dans la société qui sont souvent très néfastes.
TROISIÈME MYTHE : « L’ISLAMOPHOBIE N’EST PAS DU RACISME, CAR LES MUSULMANS NE SONT PAS UNE RACE »
On affirme souvent que « l’islamophobie n’est pas une forme de racisme parce que les musulmans ne sont pas une race, mais plutôt des adeptes d’une religion spécifique ». Une telle remarque n’a cependant de sens que si l’on croit que l’humanité peut être divisée en races clairement distinctes les unes des autres. On affirme alors que le racisme ne peut s’appliquer que lorsqu’on méprise ou discrimine autrui en raison de ses caractéristiques raciales.
Or, scientifiquement parlant, l’idée que l’on puisse diviser l’humanité en races a été abandonnée depuis longtemps. Pourquoi alors cette affirmation est-elle si souvent répétée ?

Quand on dit que « l’islamophobie n’est pas du racisme », on cherche en réalité à se protéger contre « l’accusation de racisme » en précisant qu’il s’agit « d’autre chose » (par exemple, de critique religieuse). Cela s’explique en partie parce que beaucoup pensent que le racisme ne concerne que la discrimination fondée sur des caractéristiques corporelles comme la couleur de peau, et que la discrimination sur la base de caractéristiques perçues comme religieuses ou culturelles ne peut donc pas être qualifiée de racisme.
Deuxièmement, cela renforce implicitement l’idée moderne selon laquelle la religion est une affaire de libre choix. En choisissant l’islam, dit-on, les musulmans menaceraient « notre culture » par l’islamisation, ce qui est perçu comme un grand danger, puisque « notre culture » serait supérieure et meilleure. Pour étayer cette perception, on invoque souvent des exemples comme les crimes d’honneur et d’autres formes de violence, l’intolérance ou l’oppression des femmes, censés être « typiques » de l’islam, etc. Ainsi, lorsque des personnes choisissent d’être musulmanes, elles seraient en réalité aussi en faveur ce genre de pratiques.
Ce qui nous amène au troisième élément : l’idée que ce que font les musulmans est le résultat direct de l’islam, indépendamment de la manière dont chaque individu vit et pratique sa foi. Ce ne seraient donc pas leurs caractéristiques raciales, mais bien leur conviction religieuse qui les pousserait nécessairement dans cette direction.
L’argument du « choix » d’être musulman (ou non) est souvent avancé dans les débats pour affirmer que l’islamophobie constituerait une catégorie totalement différente du racisme, du sexisme, de la xénophobie ou de l’homophobie. Bien qu’une telle distinction puisse avoir une certaine pertinence, la réalité est en fait bien plus nuancée.
Dans les débats publics sur l’islam et les musulmans, dans les politiques publiques, et dans les discriminations quotidiennes, la position personnelle de l’individu importe peu. Des groupes spécifiques comme les Hollandais d’origine marocaine, turque ou iranienne sont souvent perçus comme musulmans, en partie à cause de leurs origines familiales, de leur apparence (couleur de peau ou tenue vestimentaire), ou de leurs pratiques culturelles.
En d’autres termes, des individus sont définis comme musulmans parce que d’autres perçoivent certains signes comme « islamiques ». Leurs corps et leurs coutumes, en tant que membres de groupes culturels spécifiques, sont ainsi mis en évidence et l’étiquette « islam » s’inscrit sur leur front.
Dans le racisme antinoir, il s’agit d’une sélection d’idées stéréotypées biologiques et culturelles sur les personnes, faisant de la couleur de peau un stigmate imposé. Dans l’islamophobie, l’aspect déterminant du racisme est surtout constitué d’une sélection d’idées stéréotypées religieuses et culturelles sur les caractéristiques des musulmans. L’islam et l’identité musulmane deviennent ainsi des stigmates imposés.
L’argument du « libre choix » a alors bien peu de poids et relève souvent du subterfuge. Cela apparaît aussi dans d’autres facettes du discours islamophobe : il est fréquent d’entendre que l’islam est une religion extrêmement contraignante, surtout pour les femmes qui y seraient fortement opprimées. Il semble que soudainement l’argument du libre-choix n’existe plus, car selon cette optique l’islam ne serait pas quelque chose que l’on choisit, mais quelque chose qui s’impose.
De plus, l’histoire montre que même lorsque des musulmans se convertissent, par exemple au christianisme, ils peuvent rester victimes de persécutions systématiques simplement parce qu’ils ont été musulmans auparavant, et que, selon leurs persécuteurs, ils le demeurent malgré leur conversion. Ce fut le cas, par exemple, pendant et après la chute de Grenade en 1492.
Il faut également souligner que, dans le débat public sur « l’intégration », l’accent s’est – ces dernières années – fortement déplacé vers l’islam, au point que les mots « immigré » et « musulman » sont parfois utilisés comme des catégories interchangeables. L’auto-identification et le choix personnel de l’individu n’ont alors que peu d’importance. La personne est assignée par d’autres à un groupe déterminé et ensuite problématisée comme membre de ce groupe.
Peu importe que des gens s’identifient ou non au label « musulman » : si l’on est issu de certains pays (ou si nos parents ou grands-parents viennent de là), on est considéré dans les politiques publiques, dans le débat social et dans la vie quotidienne comme étant musulman.
L’islamophobie ne se réduit donc pas seulement à une question de « race ». Elle ne se limite pas non plus aux préjugés ou aux stéréotypes. Elle concerne surtout le rapport de force et de pouvoir. Ce que les musulmans pensent de l’islam, ou la manière dont ils la vivent ou non au quotidien, importe peu : une définition particulière de ce qu’est « l’islam » et de ce qui est « musulman » leur est imposée. Et cette définition postule que l’islam est, dans son essence, différent et étranger à la culture dominante (française, belge, européenne, etc.).

Ceux qui adhèrent à une telle vision établissent donc une distinction hiérarchique entre les musulmans et les « autres », fondée sur leurs propres présupposés de l’islam, indépendamment de la compréhension et des croyances des musulmans eux-mêmes. En ce sens, l’islamophobie renvoie bien à une dynamique de racisme : celle d’un groupe dominant qui a le pouvoir de définir, hiérarchiser et cibler les minorités sur la base d’idées sur l’islam, souvent enracinées depuis des siècles.
Ainsi, en disant que « l’islam n’est pas une race », certains en viennent à racialiser les musulmans[6]La racialisation des musulmans (processus de racialisation) est le processus par lequel des groupes dominants attribuent des caractéristiques fixes et essentialisées à des personnes qui ne sont … Continue reading en termes religieux-culturels. Cette racisation est en outre renforcée par les politiques et les discours d’opinion. Car, puisque le racisme est surtout associé à l’extrême droite radicale et à ses discours biologisants contre les Juifs ou les Noirs, les politiciens et commentateurs « mainstream » peuvent condamner ce racisme biologique, tout en ignorant que le racisme reste un élément central de l’État-nation occidental.
Conscients ou non, ils continuent de voir les hommes blancs comme la norme culturelle, et considèrent comme allant de soi que les autres doivent s’y conformer autant que possible. Ce faisant, ils entretiennent aussi l’image du citoyen blanc comme tolérant, pacifique et supérieur — et celle de « l’autre » comme son opposé.
En d’autres termes : oui, les musulmans ne sont pas une race. Les « races » n’existent pas, mais le racisme, lui, existe bel et bien. Et l’islamophobie peut être très adéquatement analysée et nommée comme une forme de racisme dirigée contre les musulmans.
QUATRIÈME MYTHE : « L’ISLAMOPHOBIE NE TUE PAS »
Kamal Raza Butt, Marwa el-Sherbini, Mohamed Aadan, Deah Shaddy Barakat, Yusor Mohammad Abu-Salha, Razan Mohammed Abu-Salha, Sunando Sen, Mohammed Saleem, Balbir Singh Sodhi, Enver Şimşek, Abdurrahim Özüdoğru, Süleyman Taşköprü, Habil Kılıç, Mehmet Turgut, İsmail Yaşar, Theodoros Boulgarides, Mehmet Kubaşık, Halit Yozgat, Michèle Kiesewetter, Hasan Džananović, Mucaad Ibrahim…

Pour la plupart d’entre nous, ces noms ne diront pas grand-chose. Pourtant, il s’agit d’une liste très succincte de personnes qui ont été tuées par des violences racistes au cours des deux premières décennies du XXIᵉ siècle, parfois spécifiquement de violences islamophobes. Le dernier nom, Mucaad Ibrahim, est celui d’un petit garçon de trois ans, assassiné lors de l’attentat terroriste contre la mosquée Al Noor à Christchurch en mars 2019. Cet attentat avait fait encore 49 autres victimes.
Et pourtant, on affirme régulièrement que l’islamophobie ne tue pas. Ce mythe est fortement lié aux deux précédents : puisque l’on prétend qu’il ne s’agit pas d’une phobie, mais seulement d’une peur légitime de l’islam — et qu’il ne serait donc pas question de racisme, mais uniquement d’une critique de religion —, alors cela ne pourrait être qu’une composante nécessaire du débat public, qui alimente la discussion, mais sans constituer un phénomène problématique.
On retrouve ici, encore une fois, la vision paradoxale de la relation entre croyances et individus, déjà abordée lors de la discussion du deuxième mythe : les convictions islamiques rendraient par définition les musulmans intolérants et violents, tandis que l’hostilité envers l’islam et les opinions qui en découlent n’auraient, d’une manière ou d’une autre, aucune conséquence. Même parmi les musulmans, on entend parfois : « Combien de temps faudra-t-il encore avant qu’il y ait des morts ? » Or, il y en a déjà.
Surtout à la lumière de l’attentat terroriste bien connu d’Anders Breivik, de telles affirmations sont particulièrement frappantes. Certes, cet attentat ne visait pas directement des musulmans, mais il visait bien l’islam, comme on peut le lire dans son manifeste. Son attaque, le 22 juillet 2011 en Norvège, ciblait de jeunes militants de gauche parce qu’à ses yeux, ils se montraient beaucoup trop complaisants envers « l’islamisation » et le multiculturalisme. Autrement dit, il voulait les tuer parce qu’ils « faisaient entrer le cheval de Troie », en ne s’opposant pas assez aux musulmans.
En Allemagne, la NSU a mené une série d’attentats mortels contre des Turcs allemands. En Belgique, le groupe nazi « Bloed, Bodem, Eer en Trouw » (« Sang, Sol, Honneur et Fidélité ») projetait de commettre des attentats terroristes et d’en faire porter la responsabilité aux musulmans, afin de déstabiliser le pays et de préparer une prise de pouvoir fasciste[7]Belga, BBET had plannen om Filip Dewinter te vermoorden De Standaard, 12-09-2006.
En Angleterre, il y eut des attaques contre des mosquées[8]Jonathan Githens-Mazer & Dr Robert Lambert (eds.), Islamophobia and Anti-Muslim Hate Crime: UK Case Studies, University of Exeter, European Muslim Research Centre, 2010., une attaque contre des fidèles à Londres[9]Vikram Dodd and Matthew Taylor, London attack: ‘Aggressive’ and ‘strange’ suspect vowed to ‘do some damage’, The Guardian, 20-06-2017, ainsi qu’un meurtre visant un homme à Birmingham[10]Birmingham Live, Mohammed Saleem murder: ‘Race war’ student Pavlo Lapshyn faces life sentence, 25-10-2013. Et aux États-Unis, un sikh et un Américain d’origine indienne ont été tués parce qu’on les avait pris pour des musulmans[11]Saldef, The First 9/11 Backlash Fatality: The Murder of Balbir Singh Sodhi, 30-082011; New York Times, 2012, Woman Is Charged With Murder as a Hate Crime in a Fatal Subway Push, 30-12-2012.
De plus, l’idée selon laquelle « l’islamophobie ne tue pas » ne tient nullement compte des développements en dehors de l’Europe et des États-Unis. Le caractère islamophobe de l’épuration ethnique en Birmanie contre les musulmans rohingyas saute pourtant aux yeux. Pour ce type de violences collectives, on peut également se tourner vers le passé récent de l’Europe : le génocide de Srebrenica en 1995.

Malgré tout, le motif islamophobe de certains actes violents est régulièrement nié. Cela apparaît clairement lorsqu’on examine de plus près certains exemples concrets comme le meurtre de Marwa el-Sherbini. Cette femme allemande d’origine égyptienne fut poignardée à mort en 2009, au cours d’un procès dans un tribunal allemand. La présence de l’accusé et de Marwa el-Sherbini devant la cour faisait suite à un litige survenu dans une aire de jeux, où la police avait dû intervenir. Au départ, l’événement suscita à peine l’attention des médias, et encore moins la reconnaissance du motif islamophobe.
Quiconque essaie de réduire ce meurtre à une simple querelle entre deux individus doit tenir compte du fait que l’agresseur l’avait traitée de « pute musulmane », de « terroriste » et « d’islamiste » lors de leur altercation sur l’aire de jeux[12]Steffen Winter, “Bloßer Hass”, Der Spiegel, 31-08- 2009. Lors du procès relatif à cet incident — où il était poursuivi pour diffamation —, il avait d’ailleurs déclaré sans détour que « des gens comme elle » n’étaient pas de vrais êtres humains et qu’on ne pouvait donc pas vraiment les insulter[13]Sven Heitkamp, Polizei ermittelt wegen heimtückischen Mordes, Die Welt, 03-07-2009.
Les violences ne s’expliquent presque jamais par un seul motif. En général, elles résultent d’une combinaison de plusieurs causes, facteurs et déclencheurs. Cela vaut aussi pour les agressions physiques et les meurtres islamophobes. Les explications données par les auteurs, les victimes ou les témoins sont rarement univoques et complètes. Mais ce qui distingue les violences islamophobes, c’est que les médias et les responsables politiques les interprètent souvent de manière à faire disparaître ou à minimiser le motif raciste et islamophobe.
Bien entendu, les meurtres de musulmans par des personnes blanches ne sont pas tous islamophobes. Mais il est frappant de constater combien de fois ces violences sont systématiquement expliquées par les « détracteurs de l’islam » de manière à effacer du tableau le racisme et l’islamophobie afin de préserver leur propre idéal d’une société blanche sans racisme et d’une « saine critique de l’islam ».
CINQUIÈME MYTHE : « L’ISLAMOPHOBIE N’EXISTE PAS »
Les affirmations mentionnées ci-dessus conduisent beaucoup de gens à la croyance erronée que l’islamophobie n’existe pas. Dans les discours qui visent à soutenir cette thèse, on retrouve constamment, sous différentes formulations, deux arguments principaux censés démontrer que l’islamophobie n’existerait pas :
- On ne doit pas utiliser le mot « islamophobie », car contrairement à l’antisémitisme et au racisme, il ne s’agirait pas d’une catégorie valide. Le phénomène n’existerait tout simplement pas puisqu’il n’y aurait pas de discrimination envers les musulmans en tant que tels.
- L’islamophobie serait un terme problématique, utilisé de manière tactique par certains afin de rendre impossible toute critique légitime de l’islam. Ce serait une façon de museler notre liberté d’expression concernant une religion particulière.
L’idée selon laquelle le mot « islamophobie » servirait à interdire toute critique de l’islam n’est en fin de compte rien d’autre qu’un exemple typique d’un raisonnement fallacieux que l’on appelle « straw man » : on invente un problème qui n’existe pas, puis on s’y oppose avec force.
En effet, personne n’affirmera que vous teniez un propos islamophobe lorsque vous exprimez votre rejet de certaines doctrines agressives défendues par quelques théologiens musulmans. À moins, bien sûr, que vous ne formuliez ce type de critique uniquement lorsqu’il s’agit de musulmans et de l’islam. Cela ne signifie pas pour autant que l’islamophobie et la critique de l’islam ne se recoupent jamais. Bien au contraire.

Trois composantes peuvent faire basculer une critique de l’islam dans l’islamophobie. On les retrouve également dans d’autres formes de racisme : (1) les hiérarchies et représentations héritées de l’histoire, (2) l’essentialisation et (3) la généralisation.
L’hostilité et la défiance à l’égard des musulmans existent en Europe depuis des siècles. Elles se manifestent par des représentations de l’islam comme étant une fausse religion, des musulmans qui sont assimilés à des barbares, ou des femmes musulmanes qui sont vues soit comme séductrices, soit comme opprimées, etc.[14]Pour autant, cela ne veut pas dire que ce rejet et cette hostilité constituent un trait essentiel des Européens à travers l’histoire.
À côté de cette composante historique, l’essentialisme culturel est déterminant pour comprendre quand une critique de l’islam devient islamophobe. L’essentialisation culturelle conduit à considérer les individus avant tout comme des sujets culturels ou religieux, sur la base d’idées que l’on se fait de « l’autre » (considéré comme inférieur ou non) et de sa culture ou de sa religion. Les individus sont alors vus comme des porteurs d’une culture ou d’une religion particulière, rattachée à une région spécifique, et présentée comme clairement distincte des autres cultures. La culture devient ainsi quelque chose à laquelle on « appartient » et qui définit votre essence. Elle est perçue comme un « objet » en soi, qui explique vos comportements indépendamment du contexte. Autrement dit : la personne (« l’être ») et les actes (« l’agir ») des individus seraient entièrement déterminés par leur culture. Plus précisément encore : leur « être » et leur « agir » seraient déterminés par l’image que d’autres se font de leur culture.
C’est là qu’intervient aussi la troisième composante : à travers cette image de l’islam, de larges groupes de musulmans sont mis dans le même sac. Parfois, on distingue entre « musulmans modérés/libéraux » et « musulmans radicaux », mais cela reste une généralisation sur un groupe extrêmement divers de plus d’un milliard de personnes. De plus, il s’agit d’une généralisation sélective et stéréotypée : lorsqu’un musulman fait quelque chose de positif, il n’est pas considéré comme représentatif de l’islam et des musulmans (mais éventuellement comme un exemple d’intégration réussie) ; en revanche, lorsqu’un musulman fait quelque chose de négatif, il est immédiatement perçu comme représentatif de l’ensemble de sa communauté. Cette généralisation excessivement sélective peut être qualifiée d’hypergénéralisation.
Outre l’essentialisme culturel/religieux, l’essentialisme biologique joue également un rôle dans l’islamophobie. Des recherches américaines sur les musulmans noirs et des recherches européennes sur les musulmans blancs montrent, par exemple, que les musulmans blancs et noirs ne vivent pas l’islamophobie de la même manière que ceux perçus comme arabes.
Appliqué à la critique religieuse et au racisme, cela signifie qu’une critique des doctrines religieuses, des déclarations ou des pratiques de dirigeants religieux ou de fidèles n’est pas nécessairement du racisme. Mais lorsque cette critique repose sur l’essentialisation et la généralisation – et surtout lorsqu’elle s’appuie sur des préjugés et stéréotypes historiquement construits – elle tombe bel et bien dans le champ du racisme. Lorsqu’on commence à juger et traiter des personnes en fonction d’une appartenance de groupe (par exemple, le fait « d’être musulman »), plutôt qu’en fonction de leurs comportements individuels, on est sur le terrain du racisme. Quand bien même cela peut être qualifié de critique religieuse, il s’agit alors d’une critique religieuse raciste.
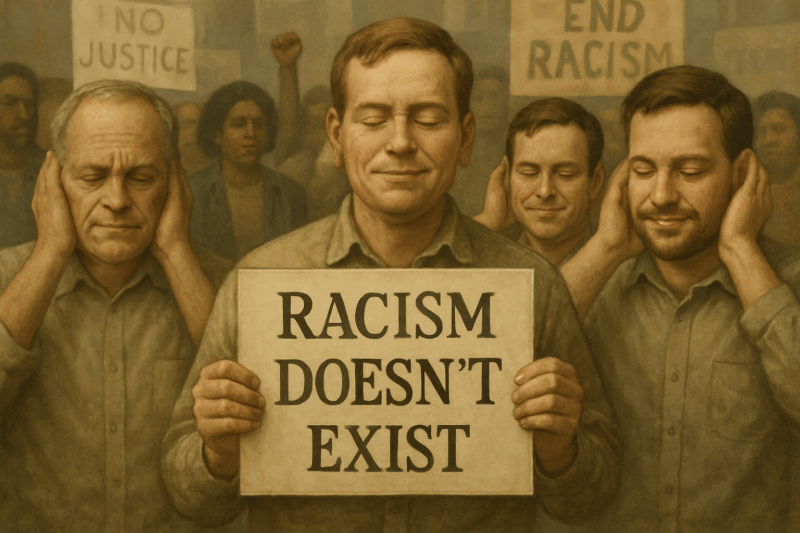
La conclusion est donc que certaines formes de critique sont à la fois islamophobes et racistes. C’est le cas, à titre d’exemple, pour ceux qui affirment que certaines interprétations du jihad prouvent que tous les musulmans sont, partout et toujours, agressifs et dangereux, et qu’il faudrait donc les traiter différemment des autres. On parle d’une critique islamophobe lorsque quelqu’un affirme que la peur de l’islam et de tous les musulmans est logique ou justifiée, sous prétexte que certains musulmans commettent des attentats terroristes.
L’islamophobie peut aussi se manifester dans les politiques publiques (islamophobie d’état). Lorsqu’une personne est étiquetée comme musulmane, elle peut être traitée différemment et son droit à l’égalité de traitement n’est pas défendu avec la même vigueur que celui des autres. Dans les politiques d’intégration, par exemple, les sentiments d’aversion à l’égard des musulmans et de l’islam peuvent être mobilisés pour justifier une focalisation particulière sur les musulmans, ce qui les vise plus que les autres et/ou les oblige à prouver leur « intégration » – pensons par exemple aux diverses interdictions du voile dans plusieurs pays européens. Ces choix politiques relèvent également de l’islamophobie. De la même manière, il est question d’islamophobie lorsque des musulmans sont moins bien traités que d’autres dans l’administration ou devant les tribunaux.
L’islamophobie est donc en partie une question de préjugés et de stéréotypes, mais aussi une question d’interventions et de catégorisations par les institutions publiques, les responsables politiques et les leaders d’opinion, qui désignent les musulmans comme un groupe particulier nécessitant des mesures spécifiques.
Ces manifestations concrètes de l’islamophobie reposent à la fois sur des émotions (peur et haine), sur des stéréotypes et stigmates religieux et culturels (« l’islam est une fausse foi », « les musulmans ne sont pas de vrais citoyens ») et sur certaines formes de politique de pouvoir (« ceci est notre pays », « notre mode de vie »). En tout état de cause, l’islamophobie est bel et bien une réalité.
__________________________________________________________________
Nos frères et sœurs à Gaza subissent actuellement un génocide rendu possible, soutenu et financé par un grand nombre de pays occidentaux. Ne les oublions pas dans nos invocations.
__________________________________________________________________
Références
| ↑1 | https://www.kifkif.be/files/E-books/Vijf-mythen-over-islamofobie/islamofobie-martijn_20190523.pdf |
|---|---|
| ↑2 | Ce qui suit est un résumé de la recherche en question. |
| ↑3 | Maurice Delafosse, L’état actuel de l’Islam dans l’Afrique occidentale française, Revue du monde musulman, vol. XI, n°V, 1910, p. 53. |
| ↑4 | FN Stanley A.Cook, Chronicle: The history of religions, Journal of Theological Studies, n°25, 1924, p. 101-109. |
| ↑5 | Catherine Rampell, Ivy League economist ethnically profiled, interrogated for doing math on American Airlines, Washington Post, 07-05-2016 |
| ↑6 | La racialisation des musulmans (processus de racialisation) est le processus par lequel des groupes dominants attribuent des caractéristiques fixes et essentialisées à des personnes qui ne sont pas considérées comme faisant partie de leur propre groupe. Ils le font sur la base d’idées généralisantes concernant la « race », la culture, la religion ou la classe sociale, accompagnées de jugements de valeur négatifs et de conceptions sur la manière de traiter un tel groupe. Il ne s’agit pas nécessairement d’étrangers explicitement perçus comme une « race », mais dans le cadre de la racialisation, on en parle de telle sorte qu’il semble bel et bien être question d’une « race » : un groupe clairement identifiable, considéré comme inférieur, auquel on attribue des propriétés spécifiques, figées et naturelles. |
| ↑7 | Belga, BBET had plannen om Filip Dewinter te vermoorden De Standaard, 12-09-2006 |
| ↑8 | Jonathan Githens-Mazer & Dr Robert Lambert (eds.), Islamophobia and Anti-Muslim Hate Crime: UK Case Studies, University of Exeter, European Muslim Research Centre, 2010. |
| ↑9 | Vikram Dodd and Matthew Taylor, London attack: ‘Aggressive’ and ‘strange’ suspect vowed to ‘do some damage’, The Guardian, 20-06-2017 |
| ↑10 | Birmingham Live, Mohammed Saleem murder: ‘Race war’ student Pavlo Lapshyn faces life sentence, 25-10-2013 |
| ↑11 | Saldef, The First 9/11 Backlash Fatality: The Murder of Balbir Singh Sodhi, 30-082011; New York Times, 2012, Woman Is Charged With Murder as a Hate Crime in a Fatal Subway Push, 30-12-2012 |
| ↑12 | Steffen Winter, “Bloßer Hass”, Der Spiegel, 31-08- 2009 |
| ↑13 | Sven Heitkamp, Polizei ermittelt wegen heimtückischen Mordes, Die Welt, 03-07-2009 |
| ↑14 | Pour autant, cela ne veut pas dire que ce rejet et cette hostilité constituent un trait essentiel des Européens à travers l’histoire. |











