Dans son roman Lettres persanes de 1721, Montesquieu développe une réflexion sur la condition des femmes orientales et musulmanes, les représentant comme des esclaves enfermées dans des harems, privées de liberté, en contraste avec les femmes de l’Europe chrétienne. Dans la lignée de cet « orientalisme féministe » de Montesquieu, le thème de la femme musulmane asservie deviendra récurrent dans la littérature française. L’image du « despotisme oriental » servira également de modèle négatif dans les écrits politiques pour dénoncer l’absolutisme français[1]Pauline Kra, “The Role of the Harem in Imitations of Montesquieu’s Lettres Persanes”.. Bien que la condition féminine n’a jamais été au cœur des préoccupations de Montesquieu, il utilise le harem comme modèle fonctionnel du despotisme[2]Joyce Zonana, “The Sultan and the Slave: Feminist Orientalism and the Structure of Jane Eyre”..

Cette image dévalorisante de la femme musulmane ne s’est pas limitée à la littérature française. Dans son texte fondateur du féminisme libéral occidental, Mary Wollstonecraft (1759–1797)[3]Wollstonecraft est considérée comme l’une des premières philosophes féministes, et les féministes citent souvent sa vie ainsi que ses œuvres comme des influences majeures. reprend, elle aussi, l’image de la femme musulmane asservie, déclarant que « dans le mahométisme, les femmes sont traitées comme des êtres subalternes, et non comme faisant partie de l’espèce humaine »[4]Mary Wollstonecraft, “A Vindication of the Rights of Woman”.
Wollstonecraft perpétue ainsi le mythe chrétien européen selon lequel, en Islam, les femmes « n’ont pas d’âme » et « naissent esclaves », s’appuyant sur cette croyance comme fondement de son argumentaire en faveur des droits des femmes en Occident. Elle établit fréquemment des analogies entre la société anglaise et le « despotisme oriental »[5]Ibid, pour dénoncer la discrimination dont les femmes sont victimes. Dès lors, l’Occident devait se libérer de ses « manières orientales » afin de devenir véritablement « occidental », c’est-à-dire plus rationnel, éclairé et raisonnable[6]Voir Joyce Zonana, “The Sultan”..
Les représentations dominantes des femmes musulmanes furent d’abord diffusées par les voyageurs européens chrétiens orientalistes du XVIIIe siècle qui était toujours des hommes, souvent très misogynes. Cette littérature de voyage servait souvent à restreindre les droits des femmes européennes chrétiennes, en présentant leur vie comme un paradis des rapports de genre, et en les menaçant du sort imaginaire de l’esclavage réservé aux femmes musulmanes si elles venaient à défier l’ordre établi[7]Bernadette Andrea, “Islam, Women, and Western Responses”..
« LES FEMMES MUSULMANES, LES SEULES PERSONNES LIBRES DE L’EMPIRE »
À ses débuts, le mouvement féministe s’est rendu publiquement complice de l’orientalisme et d’autres discours impérialistes, en contribuant à forger l’idée – encore largement répandue aujourd’hui – selon laquelle les femmes occidentales seraient les plus « libres » du monde, par opposition aux femmes musulmanes, perçues comme intrinsèquement opprimées[8]Ibid..
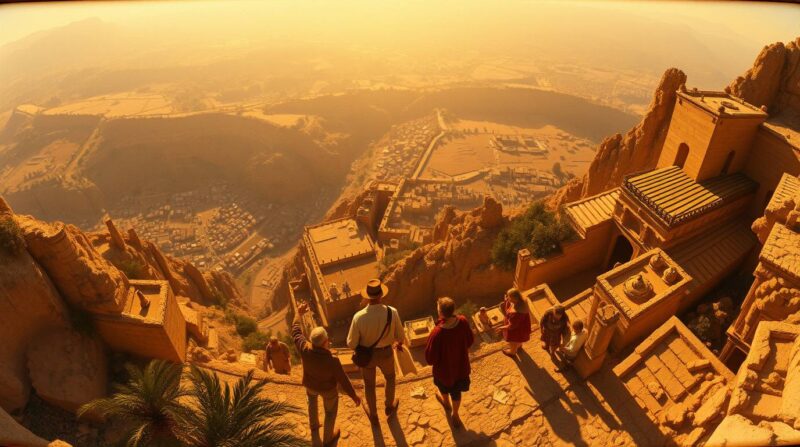
Ces représentations dominantes n’étaient cependant pas universellement partagées à l’aube de l’ère libérale en Europe de l’Ouest. Quelques voix dissidentes ont émergé, dont la plus remarquable fut sans doute celle de Lady Mary Wortley Montagu (1689-1762), épouse de l’ambassadeur britannique auprès de l’Empire ottoman en 1717–1718. Elle fut l’une des premières à remettre en question les fantasmes européens et chrétiens à propos des femmes musulmanes. Dans ses Lettres de l’ambassade de Turquie, publiées à titre posthume en 1761, Montagu offre un témoignage si élogieux des femmes musulmanes ottomanes d’Istanbul qu’elle en vient à déplorer l’absence de libertés équivalentes chez les femmes chrétiennes européennes[9]Comme décrit dans Leila Ahmed “Women and Gender in Islam”..
Elle ira jusqu’à décrire les femmes musulmanes ottomanes comme « les seules personnes libres de l’Empire »[10]Comme cité dans Bernadette Andrea, “Islam, Women, and Western Responses”.. En réponse à l’idée selon laquelle les femmes turques étaient encore plus restreintes et moins considérées que les Anglaises, elle écrit : « C’est précisément ce leurre qui aveugle les femmes occidentales sur leurs propres limitations, des limitations qui perdurent encore aujourd’hui malgré le dogme affirmant que les femmes occidentales seraient “les plus chanceuses du monde”. »[11]Bernadette Andrea, “Islam, Women, and Western Responses”.
Montagu ne fut pas la seule à faire entendre une telle voix. Au début du XXe siècle, d’autres exemples de ce que l’on pourrait appeler des « légitimations par renversement » apparaissent, notamment en Afrique. En 1913, dans Among Congo Cannibals, John Weeks (1861 – 1924) rapporte le cas du divorce à l’initiative des femmes chez les Bakongo, au Congo — à une époque où les femmes anglaises ne disposaient d’aucun droit similaire. Ce faisant, il révèle involontairement que certaines femmes africaines dites « primitives » jouissaient d’une plus grande liberté que leurs homologues anglaises, pourtant supposées libérées.
LES FEMMES MUSULMANES N’ENVIENT PAS LES FEMMES OCCIDENTALES
Dans Do Muslim Women Really Need Saving?, l’anthropologue américaine Lila Abu-Lughod[12]Lila Abu-Lughod est née aux États-Unis d’une mère juive ashkénaze américaine et d’un père arabe musulman palestinien. interpelle les féministes libérales occidentales, en reprenant les arguments des critiques féministes anticolonialistes formulées au cours des dernières décennies. Ces critiques dénoncent le racisme, les stéréotypes et la vision occidentalocentrée qui caractérisent le féminisme occidental depuis le XIXe siècle, ainsi que le rôle que celui-ci a assigné aux féministes libérales américaines, à savoir celui de « sauver » les femmes musulmanes de leurs « oppresseurs » masculins :
Mon objectif est de nous rappeler de rester attentifs aux différences et de respecter d’autres chemins vers le changement social, qui pourraient améliorer la vie des femmes. Une libération peut-elle être islamique ? Et, au-delà de cela, la libération est-elle même un objectif partagé par toutes les femmes ou tous les peuples ? L’émancipation, l’égalité et les droits font-ils partie d’un langage universel que nous devons tous adopter ? (…) Autrement dit, d’autres aspirations ne seraient-elles pas plus significatives pour certains groupes ? Vivre dans des familles unies ? Mener une vie pieuse ? Vivre sans guerre ?[13]Lila Abu-Lughod, “Do Muslim Women Really Need Saving? Anthropological Reflections on Cultural Relativism and Its Others”.

Pour beaucoup d’Occidentaux, il est difficile de concevoir que les femmes musulmanes aient leur propre vision du monde, qu’elles se considèrent déjà comme libérées par leur religion, et qu’elles n’aient nul besoin d’être délivrées par des personnes qui assimilent la liberté à la culture occidentale.
Abu-Lughod s’appuie sur ses enquêtes de terrain en Égypte pour appuyer son propos et faire entendre les voix de ses interlocutrices :
J’ai mené des recherches en Égypte pendant plus de vingt ans, et je ne connais pas une seule femme — qu’elle soit issue des milieux ruraux les plus pauvres ou de la bourgeoisie éduquée des grandes villes — qui ait jamais exprimé de l’envie envers les femmes américaines. Ces dernières sont souvent perçues comme privées de communauté, vulnérables à la violence sexuelle et à la désintégration sociale, obsédées par la réussite individuelle au détriment de la morale, ou encore étonnamment irrespectueuses envers Dieu.[14]Ibid.
Le féminisme occidental a toujours présenté des modèles de sexualité comme des instruments de libération et en a fait une lutte « internationale », dans laquelle toutes les femmes de toutes les nations pourraient s’unir autour d’un objectif « commun » où la question du genre a entièrement été figée[15]Grewal, “Transnational America”.
Dans ce contexte, la politologue américaine Anne Norton souligne que l’implication des femmes occidentales dans le « projet de libération — ou simplement de domination — du monde musulman »[16]Anne Norton, “On the Muslim Question” a aussi des répercussions sur leur propre situation :
En participant à cette campagne, [ces femmes occidentales] apprennent à considérer les modèles occidentaux de sexualité comme libérateurs, universels et au-dessus de toute critique. On les détourne ainsi de la lutte pour les droits des femmes dans leur propre société, pour les enrôler dans des projets de domination impériale.[17]Ibid.
SAUVER LES NON-EUROPÉENS DE LEURS CULTURES NON EUROPÉENNES
Les angoisses suscitées par ce que l’Europe ancienne représentait et continue de représenter — le despotisme, l’intolérance, la misogynie — ont été projetées sur l’islam. Ce n’est qu’à travers cette projection que l’Europe a pu se construire comme démocratique, tolérante et philogyne, bref, débarrassée de l’islam. Une fois l’Europe imaginée comme un lieu paradisiaque, il devient impératif, pour les Européens chrétiens et libéraux, non seulement de diffuser leur « culture » et leur mode de vie, mais aussi de sauver et de libérer les non-Européens de leurs cultures et modes de vie anti- ou non européens. Cette mission s’accomplit à travers un zèle chrétien et libéral, prêchant la démocratie, les droits des femmes, les droits sexuels, la tolérance et l’égalité, dans le but de « soigner » les musulmans et l’islam de leurs manières jugées non européennes, non chrétiennes et illibérales.
La pensée libérale européenne, qui a formulé les idéaux de liberté politique et de démocratie depuis les Lumières, est liée à l’essor des empires européens qui ont soumis une grande partie du monde à leur domination. Ce lien entre pensée libérale européenne et expansion impériale a souvent été nié, malgré leur profonde imbrication.[18]Cet article est tiré des recherches de Joseph A. Massad dans son ouvrage “Islam in Liberalism”.
Références
| ↑1 | Pauline Kra, “The Role of the Harem in Imitations of Montesquieu’s Lettres Persanes”. |
|---|---|
| ↑2 | Joyce Zonana, “The Sultan and the Slave: Feminist Orientalism and the Structure of Jane Eyre”. |
| ↑3 | Wollstonecraft est considérée comme l’une des premières philosophes féministes, et les féministes citent souvent sa vie ainsi que ses œuvres comme des influences majeures. |
| ↑4 | Mary Wollstonecraft, “A Vindication of the Rights of Woman” |
| ↑5 | Ibid |
| ↑6 | Voir Joyce Zonana, “The Sultan”. |
| ↑7 | Bernadette Andrea, “Islam, Women, and Western Responses”. |
| ↑8 | Ibid. |
| ↑9 | Comme décrit dans Leila Ahmed “Women and Gender in Islam”. |
| ↑10 | Comme cité dans Bernadette Andrea, “Islam, Women, and Western Responses”. |
| ↑11 | Bernadette Andrea, “Islam, Women, and Western Responses”. |
| ↑12 | Lila Abu-Lughod est née aux États-Unis d’une mère juive ashkénaze américaine et d’un père arabe musulman palestinien. |
| ↑13 | Lila Abu-Lughod, “Do Muslim Women Really Need Saving? Anthropological Reflections on Cultural Relativism and Its Others”. |
| ↑14 | Ibid. |
| ↑15 | Grewal, “Transnational America” |
| ↑16 | Anne Norton, “On the Muslim Question” |
| ↑17 | Ibid. |
| ↑18 | Cet article est tiré des recherches de Joseph A. Massad dans son ouvrage “Islam in Liberalism”. |










